
MATHIEU JAHNICH (consultant-chercheur en communication responsable) : « Revoir la manière de communiquer, c’est d’abord repenser le modèle économique des entreprises »
18 juillet 2024
Timothée QUELLARD (ekodev) : « Les activités des entreprises ont un impact négatif sur la biodiversité et sont destructrices du vivant. »
16 septembre 2024Martin RICHER (Management & RSE) : « Le contexte actuel exige de passer de la conception traditionnelle, la RSE réparatrice, à une approche plus proactive, la RSE transformative »
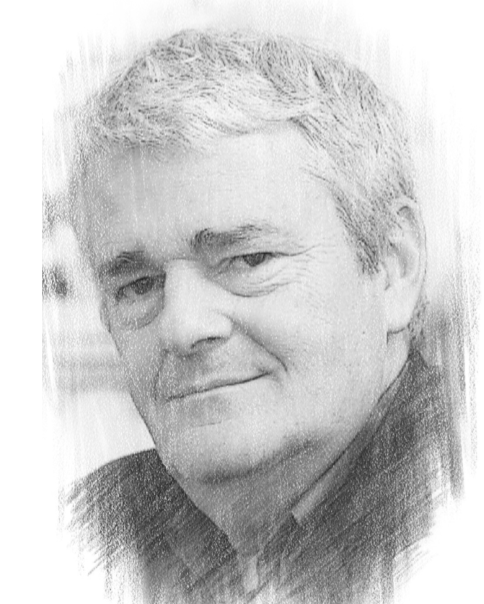
Diplômé d’HEC, Martin Richer a effectué la plus grande partie de son parcours dans le Conseil et le marketing de solutions de haute technologie en France et aux États-Unis. Il a notamment été directeur du marketing d’Oracle Europe et Vice-Président Europe de BroadVision. Il a rejoint le Groupe Alpha en 2003 et a intégré son Comité Exécutif tout en assumant la direction générale de sa filiale la plus importante (600 consultants) de 2007 à 2011. Depuis 2012, il exerce ses activités de conseil dans le domaine de la RSE. Il est ainsi fondateur et président de Management & RSE.
– Pourquoi pensez-vous que notre conception de l’entreprise n’est plus soutenable ?
Qui peut croire que nous pourrions continuer impunément à consommer chaque année 1,7 fois les ressources que notre planète est capable de régénérer (source : Global Footprint) ? Que le creusement des inégalités (qui heureusement épargne la France), dépassant les niveaux les plus élevés depuis la fin de la seconde guerre mondiale, nourrissant la montée des populismes, n’éclatera pas en révoltes sociales ? L’épuisement des ressources physiques est une corde de rappel qui souligne l’autre épuisement, celui de notre capacité à refonder un modèle de croissance soutenable. Bien sûr, si les entreprises étaient seules responsables de ces dérives, le problème serait plus facile à résoudre. Chacun doit prendre sa part : citoyens, consommateurs, États, collectivités, y compris les entreprises, qui sont reconnues par les opinions publiques comme étant l’acteur le plus efficace pour prendre en charge ces enjeux. Cette confiance les oblige.
– Comment la RSE peut-elle selon vous mener à un nouveau modèle d’entreprise ?
Ce contexte exige de passer de la conception traditionnelle, la RSE réparatrice, à une approche plus proactive, la RSE transformative. La RSE est encore jeune : 70 ans de théorie et 20 ans de pratique. Nous entrons maintenant dans ce que j’appelle l’économie d’impact. La RSE avait pour objectif d’inciter les entreprises à intégrer les préoccupations sociales, sociétales et environnementales à leur fonctionnement. L’économie d’impact leur donne les outils (ODD, CSRD,…) permettant non seulement de mesurer leurs impacts mais aussi de les piloter. Le capitalisme actionnarial, que nous connaissons depuis l’après-guerre, cède progressivement la place au capitalisme des parties prenantes. L’Union Européenne (UE), qui a beaucoup fait pour imposer le cadre d’action de la RSE aux pays membres, doit maintenant prendre toute sa part, avec ses instances fraîchement renouvelées, pour aider les entreprises dans cette voie. L’UE ne peut se satisfaire ni du capitalisme actionnarial américain ni du capitalisme d’État à la chinoise, deux systèmes qui consacrent la domination d’une seule partie prenante, respectivement les actionnaires et l’État.
– Qu’est-ce que cela change, concrètement ?
Cela change radicalement le métier de dirigeant. Il n’est plus l’agent d’une seule partie prenante, à savoir les actionnaires. Son cadre d’action est désormais ce que l’on appelle la performance globale. Depuis la loi Pacte de 2019, il doit prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de l’activité de son entreprise. Il doit donc concilier des intérêts qui parfois sont alignés mais souvent en tension, et accueillir positivement cette complexité. Le dirigeant doit être capable d’écouter ses parties prenantes, de comprendre leurs attentes et de les traduire dans une raison d’être inspirante, qui devient la boussole de l’entreprise et le facteur de cohésion de son écosystème. Le dirigeant d’aujourd’hui ne donne pas des ordres mais des autorisations ; le Chief executive officer, CEO, laisse place au chief enablement officer. Il doit créer les conditions favorables à l’expression de la raison d’être de son entreprise par ses équipes, puis à sa préservation dans le temps long.
– Pensez-vous que les actions RSE des entreprises françaises sont actuellement suffisantes, notamment au regard des enjeux climatiques ?
C’est toujours difficile de répondre à cette question en mettant à distance les impressions fugaces et les anecdotes. Une bonne façon de le faire est de regarder l’évolution sur le temps long des notes données aux entreprises et aux États par les agences de notation. Dans l’ensemble, elles progressent très nettement. Mais cette progression est trop lente. Sur le climat, oui les entreprises ont fait de vrais efforts de décarbonation. Mais au rythme actuel, elles nous mènent tout droit vers un réchauffement climatique à +2,7°C. Ce n’est pas soutenable. Et nous persistons à penser que nous trouverons une voie de sortie sans refonder radicalement les modèles d’affaires, c’est-à-dire la façon dont nous créons la valeur. Les entreprises doivent agir ASAP (As Sustainable as Possible). Les trois valeurs dont elles ont le plus besoin pour affronter le mur du carbone sont aussi celles dont elles sont le plus dépourvues : de la lucidité, du courage et de la sobriété.
– Comment voyez-vous l’entreprise de demain ?
L’entreprise de demain doit être à la fois un lieu d’épanouissement individuel et de construction collective. Elle sera un groupe humain animé d’un projet collectif attentif à ses impacts. C’est un modèle que j’appelle l’entreprise contributive. Elle crée des organes de gouvernance et de régulation qui lui permettent d’ajuster ses impacts en permanence. Regardez par exemple ce que préfigurent les Comités de mission, créés au sein des sociétés à mission : elles apportent des lieux de confrontation pacifiés, des sources d’innovation. La RSE sera de plus en plus un facteur de différenciation face à des réglementations qui, inévitablement, vont continuer à se durcir, reflétant l’irritation des parties prenantes. Certes, il faut éviter de trop « entraver le marché, » comme disent les libéraux. Mais soyons lucides : le marché n’a pas l’air de subir un niveau d’entrave insupportable. Entre mars 2009 et février 2024, l’indice boursier américain Dow Jones a progressé de 489% et pour la France, le CAC40 de 175% ! Mais quid du bien commun ?
—
Les propos exprimés n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas la position du média.




